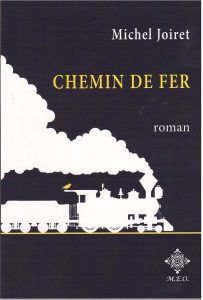Michel Joiret, Chemin de fer, roman. éd. M.E.O.
Un roman d’une belle unité. On trouverait difficilement un titre qui « colle » mieux au personnage central que celui-ci…Une enfance tourmentée, au cours de laquelle le chemin de fer, les petits trains, vont constituer une sorte de refuge, de compensation; une vieillesse solitaire, où c’est le rêve qui, peu à peu, va s’installer dans un wagon somptueux, propice aux rêves. Chaque chapitre, de plus, portera le numéro d’un quai où va s’arrêter, pour un peu de temps, la locomotive du temps…Le tout y gagne une unité certaine, et le lecteur est bercé par le bruit des wagons.
La nostalgie est au rendez-vous. On connaît l’attachement de Michel Joiret à sa ville natale, et cet amour, fidèle même si l’on en défigure les traits au nom de la mondialisation et de la globalisation, se mêle subtilement aux fragrances du chocolat Côte d’Or, parti bien loin, hélas (Rome n’est plus dans Rome), ou aux charmes de la Mort subite. Le point d’ancrage se trouve d’ailleurs à deux pas de la gare du Midi. A côté de cela, une part de choix accordée au sexe – même si le sentiment n’est pas très durable – ici, la vie familiale du héros, dans son enfance, en est responsable pour une grande part. Et puis, surtout, pour le plus grand plaisir du lecteur, des passages, assez fréquents, où l’expression, le style, semblent quitter la terre pour prendre leur envol – oui, lecteur, à ces moments-là, vraiment, ça plane pour toi. Ainsi, p.20, à propos d’un oiseau qu’on lui a offert;
Guère besoin de ces ingrédients pour mitonner sa propre cuisine, lui, l’habitué des quais et des voyages immobiles, qui n’accueille dans son intimité que le vent du nord et le sifflement des trains. Pas de Fifi, pas de compagnie duvetée et poilue, juste le silence qui suit le passage d’un convoi, quand les quais se sont vidés des attentes et de leurs innombrables valises, un silence parfumé de lointains qui roulent sur un chemin de fer…
Pour un peu, l’on se croirait dans la maison de Rimbaud à Charleville, maison aux silences rares, aux paroles absentes, où seules quelques affiches évoquent les départs, avec en bruit de fond celui des chaînes qui se tendent, des sirènes de bateaux, des sifflets de locomotives. Oui, Michel Joiret fait partie de cette famille-là, celle des grands voyageurs sans trop de moyens, où l’on retrouve Albert Cossery, Panait Istrati, Blaise Cendrars, Francis Carco, celle de Gosta Berling, du Grand Meaulnes et de bien d’autres encore.
Car la pauvreté, la vie simple sont aussi de la partie. Le héros se sustente de peu, et les gens qu’il fréquente sont des gens tout simples, des pauvres, des étrangers. C’est chez eux seulement qu’il trouve une sympathie dépourvue d’arrière-pensées.
Il y a dans ce roman un va-et-vient perpétuel entre l’enfance et l’âge mûr, comme s’il s’agissait de retrouver cette enfance perdue et de refaire un destin raté. Poursuite du temps qui est comme une quête du Graal. Graal qui pourrait être d’encre et de papier. Dans son enfance, il a pénétré dans la chambre défendue, celle du père, où il va dérober un livre. Non pas un libre scabreux, mais bien Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Le livre qui, tout comme le chemin de fer, permet de voyager. Une autre vie, plus légère, plus aérienne, mais qui reste la sœur de la première. La treizième revient, et c’est toujours la même. Même s’il doit s’habiller en magicien pour pénétrer dans la chambre défendue.
Et c’est l’oiseau qui aura le mot de la fin:
Aristote, détournant son regard, bat des ailes sur place, le temps de se dérouiller les plumes. Puis il prend son envol et file vers la fenêtre ouverte sur la liberté, avec son escorte d’oiseaux blancs qui tirent le grand char de la nuit.
De quoi rêver. De quoi vivre.
Joseph Bodson