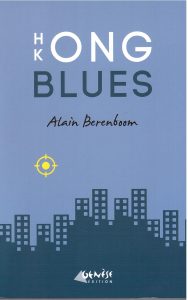 Alain Berenboom, Hong-Kong Blues, Genèse édition,2017.
Alain Berenboom, Hong-Kong Blues, Genèse édition,2017.
Les lecteurs d’Alain Berenboom vont être gâtés par ce polar touffu à plaisir, qui se lit d’une traite, et amène, ce qui n’est pas négligeable, à se poser bien des questions.
Des questions sur son personnage, Marcus Deschanel, sur Alain Berenboom lui-même, sur le polar, sur Hong-Kong, bien sûr, sur les Chinois, sur l’humour, sur les femmes, sur le sens de la vie (pourquoi pas?). Rassurez-vous, vous n’en sortirez pas avec des maux de tête, mais en voyant certaines choses d’un autre œil, peut-être bien. Et que serait-ce qu’un polar où l’on ne poserait pas de questions?
Un ingrédient essentiel; l’atmosphère. Très moderne, ici: Skype n’y est pas pour rien. Mais aussi un regard aiguisé, sur la ville, ses habitants, ce qui n’empêche pas la beauté du ciel nocturne sur la ville d’y trouver aussi place, et c’est très réussi: Lorsque je rouvre les yeux, la nuit tombe en même temps qu’un vilain crachin. De la fenêtre de mon petit appartement, je contemple un ciel bleu électrique, dans lequel passent des amas de nuages sombres, percés de milliers de néons multicolores. Au loin, les lueurs du port, le fanal des bateaux de pêche et des jonques, au milieu de la forêt de lumières des gigantesques navires de croisière. Les points rouges des avions semblent des signaux lancés par des extraterrestres. Ils passent pratiquement en rase-mottes au-dessus de la ville. (p.52)
Des personnages, aussi, bien sûr. Eux aussi sont assez réussis. Pas de super-héros en blouson de cuir, la mèche sur le front, l’œil toujours aux aguets. Pas non plus un intellectuel de haut vol. Il écrit, c’est vrai, mais c’est plutôt dans la rubrique des chiens écrasés. Il réfléchit, à son présent, à son passé, il se remet en question. Il y a du sexe, bien sûr, mais il y a surtout l’amour pour sa petite fille, qu’il retrouve sur Skype. Non, pas un super-héros, plutôt un paumé, qui évoque parfois l’Américain bien tranquille de Graham Greene. Il est prisonnier de l’intrigue comme une mouche sous une cloche à fromage. Le regret de la liberté perdue, la nostalgie. Mais ça travaille, dans sa tête, l’histoire se divise en deux grands courants qui alternent, et lui au milieu. Et puis, il y a les Chinois. Là, je vous laisse découvrir.
Quoi encore? De l’humour. Beaucoup, et du meilleur. De l’autodérision, ce qui est plutôt rare, et bien réjouissant. Des recettes, même, pour faire un bon polar, et des renseignements sur la façon dont l’auteur travaille (si c’est bien lui), p.48, pour ne rien vous cacher. Un portrait en négatif de l’écrivain, aussi.
Quoi encore? Un bistro où trône l’image de Brassens. Des romans dans le roman. Et puis, surtout, inoubliable, le dernier tango, celui qui vous laisse le blues. Un peu comme quand vous allez commencer un rhume, et que la gorge vous gratte. De plus en plus. Tellement que les larmes vous viennent aux yeux, dans le flou du soir, et que vous ne savez pas pourquoi.
C’est tout? Mais oui, bien sûr. Vous ne voulez pas que je vous raconte l’histoire, tout de même? Ou que je vous envoie ma photo?
Joseph Bodson
